Introduction : Les bailleurs sociaux face à la diversification de leur modèle économique
Le secteur du logement social en France traverse une crise majeure. Entre la hausse des taux d’emprunt, l’augmentation de la fiscalité et la raréfaction des financements publics, les bailleurs sociaux se trouvent confrontés à des contraintes financières inédites.
Pour répondre à ces défis, de plus en plus de bailleurs sociaux se tournent vers les logements locatifs intermédiaires ou "libres" (LLI). En Île-de-France, la production de LLI a fortement augmenté au cours des dernières années. En 2016, on produisait un LLI pour neuf logements sociaux, une proportion qui est passée à un LLI pour trois logements sociaux en 2020. Depuis 2021, près de 18 000 logements LLI sont produits chaque année, avec un pic à plus de 30 000 en 2023.
Cette dynamique est renforcée par le cadre législatif : l’article 7 du projet de loi n° 573 envisage de doubler le volume de logements intermédiaires que les bailleurs sociaux peuvent détenir directement, à hauteur de 20 % de leur parc locatif social, contre 10 % aujourd’hui.
L’étude « Promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, collectivités locales » (Bonneval & Pollard, 2017) souligne que les bailleurs sociaux deviennent des acteurs hybrides, naviguant entre mission sociale et logique de marché. Dans ce contexte, la commercialisation des LLI se situe à la croisée des chemins : elle doit concilier objectifs économiques, mission sociale et attentes des locataires, tout en renforçant la performance globale du bailleur.
Si la commercialisation des LLI permet de diversifier l’offre, d’optimiser les revenus et de renforcer la mixité sociale, elle ne s’improvise pas : elle nécessite des choix stratégiques, une compréhension fine du marché et une organisation opérationnelle rigoureuse.
Enjeux et spécificités : Louer sans contraintes, mais pas sans stratégie
Contrairement aux logements sociaux classiques, un logement locatif libre est proposé sur le marché sans plafond de loyer, ce qui élargit naturellement le public potentiel. Il s’adresse ainsi à des ménages qui ne remplissent pas nécessairement les critères habituels pour une demande de logement social. De plus, sa commercialisation dépend d’un cadre réglementaire beaucoup plus souple : par exemple, il n’existe pas d’obligation de juste occupation ni de priorisation des publics vulnérables, ce qui laisse au bailleur une marge de manœuvre plus importante pour définir sa stratégie.
Ainsi, la commercialisation des LLI doit permettre de répondre à plusieurs enjeux essentiels :
- Financiers : optimiser le rendement locatif et limiter les périodes de vacance.
- Opérationnels : garantir un processus fluide, de la mise en ligne des offres jusqu’à l’entrée dans le logement.
- Marketing : renforcer l’image du bailleur et attirer des locataires diversifiés, séduits par la qualité et la transparence du processus.
Toutefois, la commercialisation des LLI s’accompagne également de défis à relever :
- La concurrence accrue, surtout dans les zones tendues où il est nécessaire d’être attentif aux loyers pratiqués ainsi qu’aux services proposés par les concurrents.
- Le respect des obligations légales et fiscales liées à la location libre
- L'adaptation aux évolutions du marché et aux attentes des locataires, notamment en matière de services numériques et de flexibilité
- Et surtout, la cohérence avec sa mission sociale, pour que le développement des LLI n’affecte pas l’attribution équitable des logements sociaux classiques.
En effet, dans une note juridique intitulée "Commissions d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) - Règles d'attribution et fonctionnement" publiée en Juillet 2025, l'USH rappelle que :
Si la législation n’interdit pas de détenir du parc non-conventionné et non financé par l’Etat, l’ANCOLS a commenté cette situation dans son rapport de 2015 en relevant que « Dans une part significative des organismes contrôlés, majoritairement des SA d’HLM, l’Agence relève que le parc géré comprend des logements non conventionnés financés sur fonds propres et prêts bancaires banalisés qui ne font l’objet d’aucun encadrement en termes de plafonds de ressources et de plafonds de loyers, et dont l’attribution ne respecte aucune procédure formalisée en garantissant la transparence ».
L’ANCOLS conclut ainsi, « Cette pratique fait question au regard de l’objet social et du financement public de ces organismes. Dès lors, à l’occasion de ses contrôles, l’Agence demande systématiquement aux organismes gérant des logements non conventionnés que soient fixés, par le conseil d’administration, des plafonds de ressources et de loyers, et que l’attribution des logements suive une procédure transparente ».
Pour réussir, un bailleur social doit donc suivre un parcours structuré, articulé autour de quatre étapes :
- Analyser le marché pour mieux définir l’offre.
- Promouvoir le logement auprès des publics cibles.
- Optimiser le processus de commercialisation et fgérer les candidatures
- Monitorer pour assurer le pilotage de la commercialisation
Du cadre contraint au marché ouvert : les bonnes pratiques pour rester maître du jeu
De la donnée à la décision : construire une offre qui séduit
Avant de commercialiser un logement locatif libre, il est crucial de comprendre la demande réelle : tous les logements libres ou intermédiaires ne trouveront pas automatiquement preneur. Une analyse fine du marché permet de positionner correctement le logement et d’optimiser les chances de location rapide. Cela passe par plusieurs étapes :
- Étude des loyers concurrents afin d’ajuster le prix au marché local.
- Segmentation du public cible : jeunes actifs, familles, seniors.
Cette étude peut également intégrer le croisement des données déjà à disposition du bailleur social : patrimoine, peuplement et demandes de logement social.
- Quels types de demandeurs souhaitent habiter cette commune ou ce quartier ?
- Qui sont les candidats qui sont le plus intéressés par les logements de cette résidence ?
- Quelles orientations stratégiques pour équilibrer le peuplement à l'échelle de l'intercommunalité ?
L'analyse du marché permet la définition d'une offre claire et attractive, premier pillier pour la réussite de la commercialisation des LLI.
En effet, il est essentiel de segmenter l’offre selon différents critères : typologie et superficie, loyer et charges alignés sur le marché, services associés (parking, balcon, ascenseur…), localisation (proximité des transports, commerces, écoles), segmentation des candidats (jeunes actifs, familles, seniors).
Certains bailleurs vont encore plus loin en testant des solutions de scoring prédictif, pour identifier les logements susceptibles de rester vacants et ajuster en conséquence les loyers ou la communication.
Une offre bien définie et segmentée constitue la première étape d’une commercialisation efficace, garantissant que le bon logement atteint le bon candidat au bon moment.
Attirer pour mieux loger : le marketing au service du bailleur
Une promotion efficace est essentielle pour toucher les bons candidats et maximiser le taux d’occupation des logements locatifs libres. Les bailleurs sociaux disposent de plusieurs leviers pour assurer la visibilité de leur offre :
- Digital : plateformes d’annonces spécialisées, sites immobiliers, réseaux sociaux.
- Partenariats locaux : agences immobilières, entreprises, collectivités.
- Communication directe : site internet, newsletters, événements.
- Valorisation du logement : photos professionnelles, visites virtuelles, vidéos explicatives.
Il est important de créer une fiche type “logement à louer” pour chaque bien, incluant photos, plan, descriptif et avantages, afin d’accélérer le processus de candidature. En effet, la transparence des informations est un facteur clé pour éviter les abandons. D'ailleurs, les bailleurs sociaux qui publient des fiches complètes — loyer, charges, prestations et état du logement — constatent un taux de candidatures qualifiées plus élevé.
Il est également crucial de définir une stratégie de communication dédiée à ces logements libres (cible différente, argumentaire différent) :les approches marketing doivent être ciblées et personnalisées. Par exemple, envoyer un e-mail à tous les candidats en attente dès qu’un logement correspondant à leur profil est disponible permet d’augmenter le taux de réponse et de réduire le délai de relocation.
Un exemple concret de mixité réussie est le quartier Ginko à Bordeaux : environ 37 % de logements sociaux, 19 % d’accession sociale et 44 % de logements à prix libre (2023). Ce dispositif montre qu’un bailleur peut intégrer une part significative de libre dans une opération globale d’habitat mixte. Le cas souligne notamment l’importance de la communication sur la mixité, la qualité de vie et les services pour attirer des occupants du segment libre.
Le parcours candidat, nerf de la guerre
Pour commercialiser efficacement les logements locatifs libres, il est essentiel d’adapter le processus aux spécificités du marché libre. Contrairement au logement social classique, les candidats sur ce segment présentent des profils différents : solvabilité, rapidité de décision et attentes variées. Selon l’étude de l’USH, « Des logements Hlm vendus et mis en location sur le marché libre » (décembre 2022), même pour un bailleur social, il est donc indispensable d’adapter le processus de qualification afin de répondre aux exigences de ce marché.
Ainsi, commercialiser un logement libre demande des compétences différentes de celles pour du logement social, il est donc indispensable d'accompagner les équipes :
- Structurer et standardiser le processus permet de gagner en efficacité et de limiter les erreurs.
- Former les équipes commerciales est crucial pour offrir un accompagnement personnalisé aux candidats.
- Assurer une prise de décision rapide et transparente renforce la confiance et réduit les délais de location.
En effet, un parcours candidat optimisé permet de réduire les abandons et d’accélérer la relocation des logements :
- Réception et qualification : vérifier la solvabilité, l’adéquation avec le logement et mesurer l’intérêt du candidat.
- Suivi et relance : automatiser les rappels et notifications pour éviter les abandons.
- Contractualisation et accompagnement : idéalement inétégrer la signature électronique et des offres spécifiques pour accompagner le locataire jusqu’à son entrée dans le logement.
L'objectif est de garantir une expérience fluide et positive dès le départ. Pour ce faire, l'exploitation des outils numériques est l'un des leviers à la disposition du bailleur social.
La digitalisation des bailleurs sociaux joue un rôle clé pour optimiser le processus de commercialisation et le suivi des candidatures.
- CRM ou plateformes de gestion locative : centralisent les candidatures et automatisent certaines étapes comme les relances et notifications.
- Visites virtuelles et visites guidées en ligne : réduisent les déplacements et augmentent le taux de réservation.
En combinant processus structuré, formation des équipes et outils numériques, les bailleurs sociaux peuvent améliorer l’efficacité de la commercialisation des LLI, réduire les périodes de vacance et offrir une expérience candidat de qualité.
Piloter, ajuster, performer : ce qu’on ne mesure pas ne s’améliore pas
Pour garantir une commercialisation efficace et réactive des logements locatifs libres, il est essentiel de mettre en place un tableau de bord spécifique avec des indicateurs adaptés. Ces KPI permettent de suivre en temps réel la performance des logements et des actions marketing, et d’ajuster la stratégie en permanence.
Définition de l’offre
- Taux de vacance des logements libres par rapport au parc disponible.
- Délai moyen de location et de rotation des logements, analysés par typologie et localisation.
Ces indicateurs permettent d’identifier les logements moins attractifs ou qui restent vacants trop longtemps, afin d’ajuster la communication ou le loyer.
Promotion et marketing
Analyse des canaux marketing performants et retour sur les campagnes promotionnelles :
- Nombre de clics
- Nombre de candidatures reçues
- Qualité des candidatures (qualification)
- Nombre de visites demandées ou réalisées.
Comparer les canaux permet de prioriser ceux qui génèrent le plus de candidatures qualifiées et d’optimiser les investissements marketing.
Efficacité du processus
- Taux de transformation des visites en signature
- Délai moyen entre la première demande et la signature du bail
- Taux d’abandon à chaque étape
- Satisfaction des locataires
- Analyse des feedbacks candidats pour améliorer l’expérience
Ces indicateurs permettent de mesurer l'afficacité de l'argumentaire et de détecter les points de friction dans le parcours candidat, c’est-à-dire les étapes où les candidats risquent de se décourager. Ils offrent également des leviers concrets pour optimiser le processus, améliorer la performance globale et garantir que chaque logement trouve rapidement preneur.
Conclusion : vers une stratégie locative globale et cohérente
La commercialisation des logements locatifs libres (LLI) constitue un levier stratégique pour les bailleurs sociaux, mais elle nécessite une approche structurée et réfléchie. En combinant outils digitaux, pratiques opérationnelles rigoureuses et communication ciblée, les bailleurs peuvent maximiser le taux d’occupation de leurs LLI tout en renforçant leur image auprès des locataires et des partenaires locaux.
Investir dans une commercialisation efficace, c’est s’assurer que chaque logement trouve rapidement preneur et contribue durablement à la performance globale du bailleur. Mais au-delà de la dimension économique, il est essentiel de préserver la mission sociale de l’organisme : développer des logements libres ne doit jamais compromettre l’attribution équitable des logements sociaux conventionnés ni nuire à la réputation du bailleur.
Lorsqu’elle est conduite avec méthode, la commercialisation des LLI permet de concilier performance économique et responsabilité sociale : la réussite passe par la cohérence d’ensemble de la stratégie. Il s'agit d'anticiper plutôt que subir, ajuster plutôt que compenser, piloter plutôt que constater. Cette capacité à allier efficacité opérationnelle, performance économique et mission sociale fait toute la différence entre un bailleur “présent sur le marché” et un bailleur réellement actif et stratégique sur le marché.
Contactez-nous pour découvrir comment Symbiose peut vous aider à devenir un bailleur actif !

.jpg)

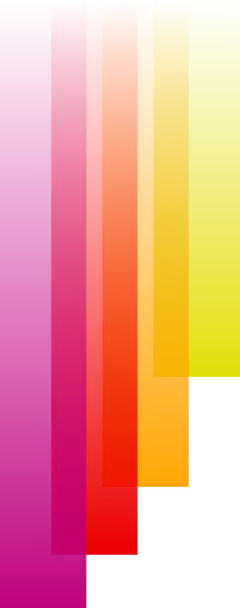
.jpg)


